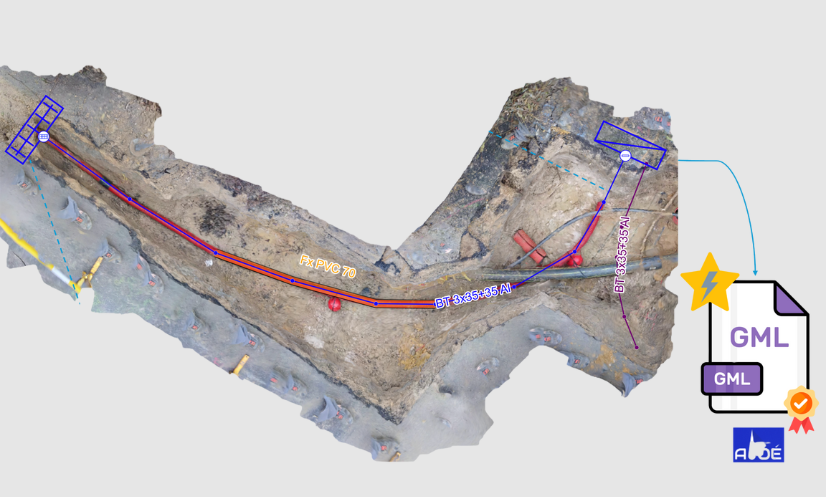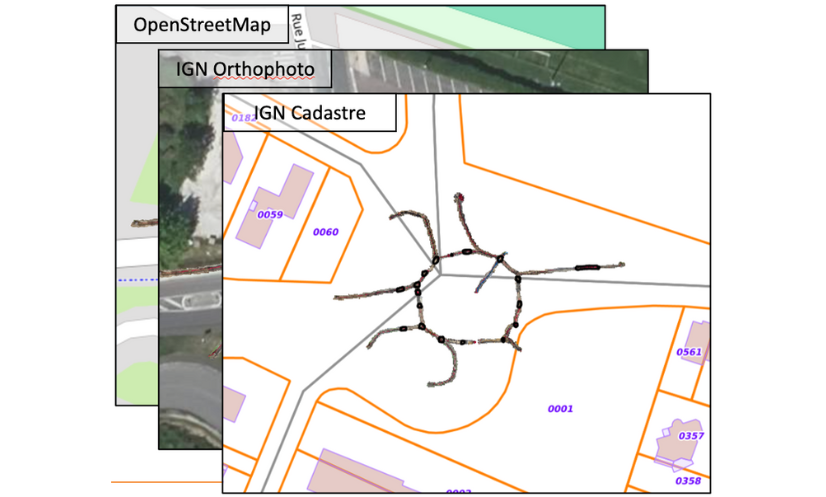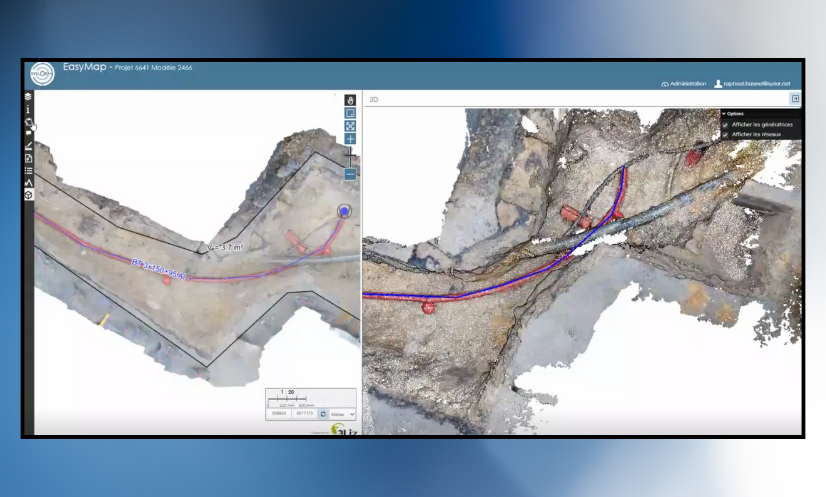EasyField évolue : nouvelles fonctionnalités pour gagner en précision et en productivité
EasyField évolue pour améliorer la productivité terrain Sur les chantiers de travaux publics et dans la gestion des réseaux enterrés, la pression sur les délais s’intensifie. Les équipes terrain doivent produire plus vite, tout en garantissant une qualité de données irréprochable. Dans cette logique d’amélioration continue, EasyField intègre de nouvelles fonctionnalités centrées sur deux priorités opérationnelles : accélérer le levé et renforcer le contrôle dimensionnel directement sur le terrain. Ces évolutions sont issues des retours utilisateurs et des usages observés sur chantier. Un levé de points désormais disponible en 1 seconde Le besoin de rapidité est l’une des demandes les plus fréquentes exprimées par les équipes terrain. Sur certains projets, le nombre de points à relever est important et chaque seconde compte. EasyField propose désormais deux modes de capture. Deux modes de capture adaptés aux contraintes chantier Un mode rapide en 1 seconde permet d’accélérer significativement les opérations de levé, notamment sur les réseaux linéaires ou les chantiers étendus. Il améliore la fluidité d’intervention et réduit le temps global passé sur site. Un mode standard en 5 secondes reste disponible lorsque l’environnement nécessite une stabilisation plus longue du signal GNSS ou lorsque l’utilisateur souhaite privilégier une consolidation supplémentaire de la mesure. Cette flexibilité permet d’adapter le levé rapide au contexte réel du chantier, sans complexifier l’usage. De nouvelles fonctionnalités de cotation en temps réel Au-delà de la rapidité de mesure, la mise à jour de l’application renforce la capacité de contrôle des géométries directement depuis le smartphone, avec deux nouvelles fonctionnalités : la cotation linéaire (partielle – segment à segment et totale ou cumulée – totale de la ligne) la cotation surfacique (information d’aire contenue dans la surface) Affichage dynamique de la distance d’un segment Lors de la création d’une polyligne, EasyField affiche en temps réel la distance entre le dernier point levé et le sommet en cours de placement. L’opérateur visualise instantanément la longueur du segment en cours, tandis que les distances partielles de l’ensemble des segments existants sont également affichées, offrant un suivi complet et précis de la polyligne à chaque nouvelle capture. Cette visualisation en temps réel permet d’ajuster immédiatement l’espacement des sommets d’un tracé et d’éviter les corrections après export. Calcul automatique de la longueur totale des polylignes Une fois la polyligne terminée, la longueur cumulée est automatiquement calculée et affichée dans l’application. L’utilisateur peut ainsi vérifier immédiatement la cohérence de la mesure avant validation. Surface calculée instantanément pour les levés surfaciques Pour les levés surfaciques, la surface est désormais calculée automatiquement dès la fermeture d’une polyligne. Cette fonctionnalité facilite le contrôle d’emprises, de zones de terrassement ou de périmètres d’intervention, directement sur le terrain. La donnée n’est plus seulement capturée : elle est contrôlée au moment même de sa production. Passer d’une polyligne à une surface Clore la polyligne pour afficher la valeur de surface Un impact direct sur la fluidité entre terrain et bureau Ces évolutions apportent des bénéfices opérationnels concrets : Le levé en 1 seconde réduit la durée d’intervention. La cotation dynamique sécurise les dimensions mesurées. La validation immédiate limite les reprises bureau. Le résultat constitue une chaîne de production plus fluide, où la donnée circule plus rapidement et avec moins d’incertitude entre opérateurs terrain, conducteurs de travaux et bureau d’études. Ces nouveautés s’intègrent dans l’écosystème EasyField Ces fonctionnalités viennent compléter les capacités déjà disponibles dans l’application. Pour découvrir le fonctionnement complet d’EasyField pour l’implantation et le levé topographique, consultez notre présentation détaillée de la solution. EasyField s’appuie également sur une précision GNSS, notamment via notre récepteur Proteus, pour garantir la fiabilité des mesures réalisées sur le terrain. Cette mise à jour s’inscrit dans une démarche continue visant à renforcer la productivité chantier tout en sécurisant la qualité des données géoréférencées. Tester les nouvelles fonctionnalités EasyField La mise à jour est disponible sur iOS et Android. Pour découvrir le levé en 1 seconde et les nouvelles fonctionnalités de cotation en démonstration, vous pouvez planifier une démonstration avec notre équipe et analyser leur intégration dans votre workflow.
EasyField évolue : nouvelles fonctionnalités pour gagner en précision et en productivité Read Post »